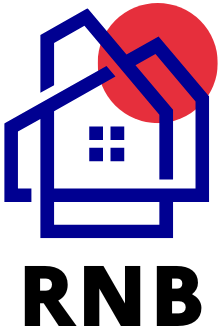🚧 Problématique
Avant la création du Référentiel National des Bâtiments (RNB), aucune définition partagée du “bâtiment” n’existait à l’échelle nationale. Cette lacune (loin d’être purement sémantique), était sources de freins à la collaboration entre services d’une même administration ou collectivité, ainsi qu’à la circulation fluide des données bâtimentaires.
Exemple concret de manque à gagner : dans une même commune, si les services techniques, financiers ou informatiques n’identifient pas un bâtiment de la même manière, des abonnements téléphoniques peuvent continuer à courir sur des bâtiments de la collectivité pourtant déjà cédés. Résultat : des dépenses inutiles et un pilotage flou.
✅ Solution apportée par le RNB
Le Groupe de travail “Bâti” du Conseil national de l'information géolocalisée (CNIG) a adopté une définition officielle et commune du bâtiment, désormais socle du RNB :
“Construction souterraine et/ou au-dessus du sol, ayant pour objectif d'être permanente, pour abriter des humains ou des activités humaines. Un bâtiment possède a minima un accès depuis l’extérieur. Dans la mesure du possible, un bâtiment est distinct d’un autre dès lors qu’il est impossible de circuler entre eux.”
Cette définition, élaborée par des experts de la donnée géomatique, se veut volontairement large pour répondre à l’ensemble des cas d’usage, tout en permettant une convergence sémantique autour d’un même objet.
🧱 Elle permet à toutes les entités publiques d’initialiser ou consolider leur base bâtimentaire à partir d’un même référentiel, ainsi de gagner du temps sur la production de nouveaux outils de pilotages à l’échelle bâti.
💬 Témoignages
”L'ID-RNB, c'est vraiment la définition de la simplification administrative gratuite. Cela nous permet d'avoir accès à de la donnée autre, autour de notre base, sans faire d'efforts et sans devoir la collecter.”, Rémi Dhalluin, coordinateur national de DataES, la base de données des équipements sportifs et des lieux de pratiques du Ministère des Sports
”Le RNB permet à différents services de ma commune de lever des problèmes d’interopérabilité entre leurs bases bâtimentaires”, - Ville d’Echirolles
🚀 Impacts concrets
Plusieurs collectivités, comme Nantes ou Saint-Martin-d’Hères, ont déjà partagé les bénéfices de cette définition du bâtiment proposée par le RNB :
- Un langage commun entre différents services (urbanisme, patrimoine, risques, etc.)
- Une meilleure interopérabilité des données au sein des intercommunalités et les acteurs avec qui ils interagissent comme les DDT ou SDIS
- Une facilité des échanges d’informations bâtimentaires en interne et externe
- Un gain de temps lors de conception de projets transverses (plus besoin de débattre sur une définition préalable)
- Des économies suscitées (assurances, abonnements eau, téléphonie), les services peuvent repérer les doublons ou les erreurs, et éviter des coûts inutiles.
🧩 En résumé
La définition commune du bâtiment, adossée à l’ID-RNB, devient un véritable pivot pour les politiques publiques. Elle transforme un simple objet géographique en levier stratégique, au service de la performance des territoires.